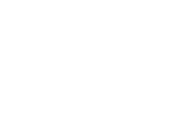Entrée et sortie du Fort Royal.
Caractéristique de la fortification « bastionnée », apparue au XVIe siècle en Italie, le bastion est un ouvrage défensif en forme de pointe qui fait partie de l’enceinte du fort. Rempli de terre afin d’amortir l’impact des boulets de canon, il facilite le tir croisé contre les assaillants.
Cette église, consacrée à Saint-Joseph en 1658, remplaça un lieu de culte plus ancien, devenu trop exigu pour la population grandissante du fort (militaires et leurs familles). Elle comporte une tribune à l’étage. Son décor peint a été restitué d’après l’original.
La courtine est une portion d’enceinte comprise entre deux bastions.
Ce bâtiment servait d’entrepôt pour la poudre à canon. Il répond à des critères de construction très stricts afin d’éviter de mettre accidentellement « le feu aux poudres » et de conserver celles-ci à l’abri de l’humidité. Pourvu d’une voûte épaisse « à l’épreuve de la bombe », il est protégé par un bastion creux et n’est pas visible depuis l’extérieur du fort.
Entrée principale du Fort Royal aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette porte était défendue du côté du fossé par une demi-lune.
La demi-lune est un ouvrage défensif « avancé », construit devant l’enceinte pour protéger une porte ou une courtine. C’est souvent là que se concentre le premier assaut de l’ennemi.
Le Fort Royal était jadis dépourvu d’eau potable. Dès l’Antiquité, les habitants du site aménagèrent plusieurs citernes monumentales ainsi qu’un système de récupération de l’eau de pluie. Ce puits du XVIIe siècle, coiffé d’un édicule à toit pyramidal, est lui-aussi pourvu de citernes.
Édifice destiné à loger les militaires, il présente un long corps central (chambre des soldats) encadré de deux pavillons à étage (logement des officiers et des sous-officiers). Les casernes du Fort Royal ne sont pas ouvertes à la visite.
La place d’armes est un espace intérieur du fort laissé libre pour le rassemblement d’une troupe.
Situé dans le bâtiment le plus imposant du fort, le musée occupe deux espaces distincts :
Le fort conserva sa vocation carcérale après la Révolution. Plusieurs centaines d’opposants à la colonisation d’Afrique du Nord y furent notamment détenus (1841-1884 env.) : smala d’Abd el-Kader, insurgés kabyles…
Le musée présente des objets archéologiques issus de fouilles terrestres et sous-marines : fragments de peintures murales antiques (âge du fer et Ier siècle), cargaison de deux épaves retrouvées aux abords de l’île (épave romaine de la fin du Ier siècle avant notre ère et une épave sarrazine du Xe siècle).
De 1972 à 1986, 14 campagnes de fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour d’importants vestiges remontant au IIIe siècle avant notre ère. Encore visibles dans la tranchée de fouilles, ces vestiges sont de 2 types :
Construite sur des vestiges romains (cryptoportiques) et reconvertie en boulangerie au XVIIe siècle, cette terrasse doit son nom au maréchal François Achille Bazaine. Accusé de trahison pendant la guerre franco-prussienne de 1870, le maréchal fut condamné à 20 ans de réclusion à Sainte-Marguerite mais s’évada, de manière rocambolesque, dix mois après son arrivée.
On remarquera au passage les puits sur citernes et l’échauguette (construction en saillie à l’angle du rempart destinée à abriter un veilleur) remarquablement conservée.
Point Info Biodiversité®. CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur.
Le Centre International de séjour Îles de Lérins.